17) La spirale
A. Le laboureur dans ‘La chute d’Icare’ de Breughel
 |
| Pieter Breughel l'Ancien, la chute d’Icare (vers 1558), Huile sur bois, 73,5cm X 112cm. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Photo source Wikimedia. |
Dans ce tableau, Breughel illustre un passage des Métamorphoses d’Ovide. Il existe deux versions du tableau, toutes deux à Bruxelles: un au Musée David et Alice van Buuren et l’autre aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. (1)
Dédale et Icare sont emprisonnés dans le labyrinthe fabriqué par Dédale. Pour s’en échapper, Dédale, avec ingéniosité, fabrique des ailes pour son fils et lui. Les plumes de ces ailes sont collées à l'aide de cire : Icare ne doit voler ni trop bas (les ailes s’alourdiraient du sel de la mer) ni trop haut (la cire pourrait fondre). Ils s'envolent donc, libres comme l’oiseau. Icare, encore bien jeune, émerveillé par sa nouvelle liberté, la chaleur et l’éclat du soleil, oublie les recommandations de son père et vole de plus en plus haut. La cire ne résiste pas à la chaleur du soleil, elle fond et Icare tombe dans la mer.
C’est cette chute que Breughel peint, dans la
tradition moralisante de ce qu’était devenu le Christianisme de son époque.
Pour l’interprétation du tableau, j’ai pris celle qui est historiquement la
plus crédible. Breughel peint cette légende grecque datant de l'antiquité dans
un décor de son temps, le XVI ° siècle. Il mélange aussi les lieux, un paysan
flamand laboure son champ alors qu’au loin on distingue les montagnes d'Italie
et le port de Naples. Breughel se moque d’Icare en ne montrant que ses jambes
qui s'agitent hors de l'eau, il est devenu minuscule détail secondaire dans le
tableau. Icare y apparaît, tel que dans les livres d’emblèmes, comme
personnification de l'orgueil. Beaucoup de tentatives d’innovation, d’invention
et de réflexion voulant élargir les frontières du savoir sont alors vues comme
une rébellion par le Catholicisme ambiant, trop souvent transformé en religion
de peur et de pouvoir. Chacun doit rester à sa place, et se contenter de faire
son travail. Et le sort du rêveur est d’être rejeté dans l’oubli ! On prête
donc à ce malheureux adolescent une faute bien noire : comme si c’était
l’orgueil qui l’avait poussé vers la Lumière !
Mais si on observe bien le
tableau, on voit qu’aucun des personnages n'ont de relation les uns avec les
autres, leur solitude est évidente. Le laboureur a les yeux rivés sur son
sillon, le pêcheur est penché sur l'eau, et le berger regarde le ciel. Chacun
s'occupe de sa tâche et personne ne voit la noyade, pas même la perdrix dont le
regard vague et lointain rappelle celui du berger qui tourne le dos au drame.
Les gens n'ont pas de temps à perdre avec la chute d'un fou. L'homme est déchu,
il est donc condamné à se racheter par son travail pour une dette qu’on lui a
collé sur le dos dès sa naissance.
Tel est la morale du tableau de Breughel qui
s’amuse, d’ailleurs, à en rajouter : à l'avant-plan, l'épée et la bourse,
posées près du laboureur, évoquent un proverbe populaire : « Épée et argent
requièrent mains astucieuses. » Un autre proverbe est aussi évoqué: « Aucun
laboureur ne s'arrête pour la mort d'un homme ». On l’a compris, à l’envolée
vers la lumière, la morale du tableau préfère le progrès lent, mais sûr, d'une
société laborieuse.
On est bien loin des paroles du Christ (évangile selon
Saint Matthieu 6,26) :
« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne
moissonnent, ils n’amassent point dans les greniers ; et votre Père céleste les
nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? » (Traduction TOB).
Le
paysan qui laboure son champ, le berger appuyé sur son bâton et le pêcheur de
dos qui tend son fil représentent trois activités liées à l'exploitation des
ressources naturelles : la culture, l'élevage et la pêche. Ce sont ces
personnages que l’on voit bien en évidence sur le tableau. C’est le laboureur,
avec sa chemise rouge et sa tunique bleue, qui apparaît d’abord au premier
plan. Il guide le soc traîné par son cheval et a déjà tracé en forme de spirale
plusieurs sillons. On peut toutefois se poser la question : Breughel était-il
d’accord avec la leçon tirée du tableau ? Ou était-ce seulement une
constatation amère ? Nul ne le saura jamais….
B. Le laboureur dans mon polyptyque ‘Icaros’
Mon polyptyque « Icaros » ne suit évidemment pas la morale
de l’époque de Breughel. Le laboureur est devenu un jouet (et le pêcheur un
enfant). Non pas par manque d’estime pour le métier d'agriculteur, mais ce
métier est devenu un jouet du système économique global. Icare l’adolescent ailé est devenu le héros, il est un des
oiseaux dont le Christ parle. Sa chute debout et tête haute doit l’entraîner de
l’autre côté du miroir. Et sur terre, Ariane est l’héroïne (on verra plus tard pourquoi). Mon tableau se veut réfuter l’amoralité ambiante et cynique du
profit à tout prix dont les artistes contemporains « en vue » ne sont que trop
souvent les complices : cela nous mène à la solitude, à l'indifférence isolant
les hommes les uns des autres et à l’ignorance de la mort de l’Icare qui
sommeille en chacun de nous.
Ne pourrait-on pas consommer moins, moins
exploiter la terre et mieux partager, maintenant que les progrès techniques nous
le permettent ? Pourquoi ne pas relire les paroles que l’on prête au Christ, pourquoi
ne pas nous rapprocher de notre prochain…et donc de nous-mêmes, puisque notre
prochain c’est nous aussi ? Parce-que les paroles que l’on prête au Christ nous
sembleraient trop folles ?
"Icaros alpha" (détails) : la spirale se retrouve
autant dans le tableau (en haut) que dans la boîte (ci-bas). Le jouet a d’abord été peint, ensuite
reproduit en vrai pour la boîte.
Ci-dessous: "Icaros beta",détail du pêcheur, et visage
d’Icare (détail). Je développerai la
symbolique des personnages d'Icare et d'Ariane plus tard, à la fin des
chapitres sur le labyrinthe.
(1) Breughel – désattribution : les deux tableaux représentant la chute d’Icare ont étés désattribués par un historien de l'art à la mode. Ces tableaux n’auraient pas été peints par Breughel ni même par un de ses élèves. Je déteste ces modes où l'on attribue et désattribue des tableaux à tour de bras. Ce sont des tableaux de très grande qualité. Rappelons-nous ce splendide tableau « Le verrou » de Jean-Honoré Fragonard : il a été attribué à ce peintre, puis désattribué puis réattribué ! Cela sert à la gloriole éphémère d’histrions de l’art qui n'ont rien trouvé d'autre pour se faire remarquer, au service de spéculateurs éhontés. Souvent on dévalorise un tableau pour l’acquérir à bon prix et le revaloriser une fois acheté. Personnellement je n’ai pas ce fétichisme absurde de notre époque pour les noms. C’est en contradiction totale avec d’autres modes de notre temps: le kitschissime Jeff Koons, la coqueluche des nouveaux riches, ne réalise aucune « œuvre » lui-même mais les fait exécuter par ses « collaborateurs professionnels » (lire : « ses petits esclaves»). C’est dans sa logique : il a d’abord été courtier en matières premières à Wall Street, autre « métier » où l’on fait travailler les autres pour soi. So what??? Un tableau nous parle ou pas. Peu importe le nom de celui qui l’a peint.


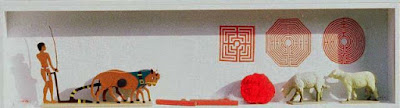



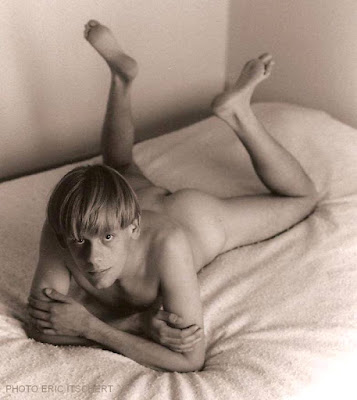

Commentaires
Enregistrer un commentaire