74) Jeune homme portant la pierre p’i
La pierre p'i dans mes dessins
A) la voie du juste milieu.
 |
| Portrait d'un jeune homme, crayons de couleur et aquarelle sur papier, 61cm x 45cm, 1995, © Eric Itschert. |
Le disque P’i réapparaît régulièrement au cou de mes
personnages, tel sur ce portrait de jeune homme ci-haut ... ou sur cet envol d'Icare dont on
voit un détail ci-bas (voir le dessin en entier)
La voie du milieu exclut tout autant un athéisme stupide
qu'une religion aliénante (1). Elle est spiritualiste.
C’est donc sagesse d’accepter nos limites, d'appréhender la
subjectivité et l’inexactitude de notre approche de l’Esprit. C’est aussi
sagesse d’accepter l’image, sous peine sinon de succomber à des illusions bien
plus sournoises. Notre cerveau est inconcevable sans notre corps. C’est une des
dernières découvertes de la neurobiologie. Il n'y a pas de schéma de pensée
abstrait sans schéma corporel sous-jacent. Vivons donc ici et maintenant avec
et en notre corps. C'est paradoxalement la meilleure manière de vivre
l'éternité!
Voilà pourquoi mes personnages sont bien ancrés dans la
matière et vivent leur sensualité sans tabous. Oui, ma peinture utilise «
l’illusion » tridimensionnelle dans la « réalité » plane du tableau. Oui elle
représente l’être humain. Et comme le monde ne s’arrête ni aux limites de notre
compréhension humaine ni à la matière, je développe une approche spiritualiste
et idéalisée de ce monde (2). Mes modèles vivent dans un merveilleux « paradis» où il fait toujours beau et chaud le jour et où il est possible de se révéler
nu sans devoir se protéger de l’autre. L’artifice du vêtement n'est pas
nécessaire, on est dans la justesse, dans Maât. Les vivants sont beaux (3).
Comme dans le disque P’i où la matière révèle le vide, le regard de mes
personnages évoque ce qui nous dépasse, « l’étincelle de Dieu » qu’il y a en
chacun de nous.
(1) Ces deux extrêmes, comme souvent, se touchent. En effet,
ils témoignent d’une vision réductrice du monde. L’athéisme est réducteur car
il arrête tout ce qui existe à ce qui est visible, la matière. Pour lui, rien
d’autre n’existe. Le fanatisme religieux est aliénant, car il réduit Hachem par
une vision anthropomorphique. Les
religions instituées nous infantilisent à dessein. On peut lire l’étymologie du
mot « religion » comme : ce qui nous relie à « Dieu ». Mais cela comporte le
danger d’imposer nos vues dues à notre culture.
On prétend savoir ce que Dieu
veut, non seulement pour soi mais pour l'autre aussi, puisqu’on est « relié » à
Dieu. Que de guerres au nom de « certitudes ». Est-ce pour cela que les
religions sont mauvaises? Je ne le crois pas, car il suffit de faire
abstraction de leurs contradictions, et d'étudier ce qui émerge en commun à
travers chacune d’elles. Alors on découvre des trésors d’intuitions et de
questionnements ! Il me paraît plus judicieux de lire l’étymologie du mot «
religion » comme Cicéron le fait : relire, remettre en question, dans une quête
permanente et jamais aboutie de la Lumière. Nous sommes aussi matière, il nous
est impossible de nous en extraire. Il est illusoire de croire qu’en supprimant
l’image nous échapperons à une approche anthropomorphique de l’Ineffable. Car
la lettre, le mot, le nombre sont encore liés au temps et à la matière.
Monothéisme, polythéisme, monisme, panthéisme sont autant d’approches
matérialistes de ce qui échappe à la matière. Toute polémique sur l'Ineffable
est vaine et n’a pas lieu d’être.
(2) … et une distanciation par rapport au cynisme dans l’art
contemporain mondain. Loin d’être une preuve de progrès, ce cynisme soumet
docilement l’art contemporain soigneusement stérilisé aux fausses valeurs de
notre temps, l’argent maître et mesure de tout. Il se révèle abominablement
rétrograde. Duchamp ne sert pas la révolution, mais bien la réaction. C’est
pour cela que le système en place tient tant à lui. Contester Duchamp comme
l’ont fait certains peintres de la nouvelle figuration est considéré comme un
acte déraisonnable. Rien pourtant n’est plus subjectif et hypothétique que
l’histoire de l’art…
(3) La beauté est
taboue dans l’art contemporain mondain. Bien sûr que la notion de beauté est
relative. Moi et mon voisin ne trouveront pas les mêmes choses « belles ».
Pourtant la beauté dépasse la barrière des cultures ! Le simple fait que des
Chinois viennent admirer la Joconde à Paris ou des Belges assister à une
exposition sur Hokusai montre ce côté relativement universel de la beauté. Moi
je n’aime pas trop la Joconde, par contre je suis fan de l’art japonais ! L’art
contemporain mondain sert d’autant plus le monde de l’argent qu’il a vidé la
question de la beauté: elle n’est plus admise que dans la publicité rendue
d’autant plus redoutable qu’elle en a obtenu le quasi-monopole.
B) Le centre.
 |
| Pierre p'i, photo © Eric Itschert |
La pierre p’i résume pour moi des concepts essentiels : son centre évoque, par le vide, l’Ineffable (développement du sujet). La « présence » de ce vide est rendue manifeste par la matière (la pierre) qui l’entoure.
Nous sommes esprit et matière, pensée et terre, âme et animalité. Pour moi une vie sage est de suivre la voie du milieu, celle qui fait chanter la cohabitation entre âme et matière, chacune révélée par l’autre.
Souvent, à travers bien des religions et des philosophies
dans le monde, le centre est réservé à « ce qui est le plus haut, ce qui est
plus grand que tout ». Prenons les mandalas dont Bouddha est le centre pour le
bouddhisme, le Linga au centre du socle et du réceptacle pour évoquer Shiva
dans l’hindouisme ou encore le centre du labyrinthe lieu de la Jérusalem céleste afin de ne citer que
quelques exemples.
Ce n’est donc pas un hasard si dans la série de mes dessins
d’Icare on retrouve parfois la pierre p’i : elle est associée à Icare et à sa
sortie du labyrinthe pour son passage dans « l’autre monde »…
 |
| Le labyrinthe de l'église latine de l'abbaye de Chevetogne, © Eric Itschert |

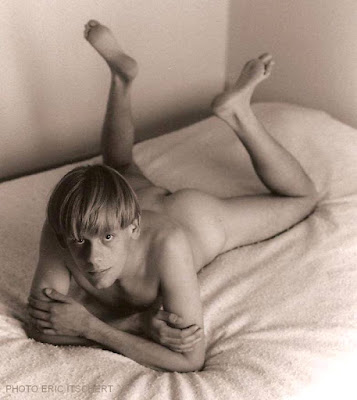

Commentaires
Enregistrer un commentaire